 https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/06/Etape-17.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-08-31 12:16:472024-08-31 12:18:15Etape 17
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/06/Etape-17.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-08-31 12:16:472024-08-31 12:18:15Etape 17TRANSMISSIONS
Recueil de nouvelles
Lu par Olivier SALADIN
Il a joué le père d’Hector MANUEL dans la pièce de Jean-Christophe MEURISSE, « Tout le monde ne peut pas être orphelin » ce qui le désigne sans hésitation pour participer au projet « Transmissions »
Au-delà de cette anecdote il faut bien convenir qu’on ne présente plus Olivier SALADIN, mais son travail est tellement varié et riche qu’un petit rappel peut-être nécessaire :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Saladin
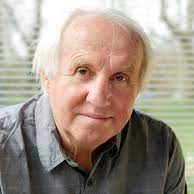
Le taxi de Cotonou (texte)
LE TAXI DE COTONOU
Il y a au Benin, dans la ville de Cotonou, un quartier du nom d’Avleketa dont la rue 306 abrite un lieu singulier ; La gare T.R.B. ( Transports Routiers Béninois). C’est là que je me suis rendu pour prendre un taxi qui pouvait me conduire jusqu’au Stade de l’Amitié. La gare routière T.R.B. est une vaste concession dont un portail bleu et blanc ouvre sur une cour, dédiée à la mécanique automobile. Il y règne une activité exclusivement masculine, remplie de sons, couleurs et mouvements comme seule l’Afrique en produit. Les masses de carrossiers font résonner des ailes et des capots mis à mal par des accrochages incessants, survenus dans les rues bondées de la capitale. Les moteurs usés par des kilomètres de pistes poussiéreuses tentent de redémarrer de chaque côté de la cour. Des mécaniciens, assistés de jeunes ouvriers, compressent des ressorts d’amortisseurs pour remplacer ceux qui sont arrivés au bout de leur vie, à force de trous, bosses et pierres qui constellent les routes. Des mécaniciens, carrossiers, peintres et autres chauffeurs s’interpellent joyeusement par-dessus des bidons d’huiles colorés. Les mécanos couchés sous les voitures laissent dépasser leurs jambes dans un ensemble multicolore de combinaisons de travail maculées de cambouis. Un car dont le moteur semblait réparé, s’étouffe dans un grand nuage de fumée blanchâtre, provoquant rires et moqueries de quelques employés, occupés à ne rien faire à l’ombre d’un grand mur.
Au milieu de cette cour des miracles, sous une chaleur vraiment écrasante, se trouvent trois Peugeot 504 dirigées vers la sortie. Elles sont jaunes avec un capot vert, comme la plupart des taxis de la ville en cette année 1989. Elles semblent prêtes à prendre la route. Je trouve à l’ombre d’un parasol publicitaire élimé, un groupe de jeunes gens désœuvrés. Je leur demande quel est le taxi qui peut me conduire au stade. On me répond qu’il n’y a aucune activité au stade en ce moment et qu’il n’y a donc pas de raison d’aller si loin, pour rien. J’insiste en disant que je m’intéresse à l’architecture et que je souhaite malgré tout y aller. L’un des jeunes gens, en train de se curer les dents, me dit de prendre place dans le second des trois véhicules que j’avais repérés. La portière du conducteur est ouverte et il y a déjà trois personnes assises à l’intérieur ; deux devant et une à l’arrière. Un homme, que j’imagine être le chauffeur, est assis sur l’aile gauche tandis qu’un ouvrier vérifie la pression des pneus. Finalement, « mon chauffeur » s’éloigne et laisse la place à un vieillard barbu vêtu d’une sorte d’uniforme beige dont la veste est couverte d’écussons colorés de marques d’automobiles, de carburants et autres accessoires mécaniques. Il me demande de m’installer contre la portière arrière droite et de bien garder la vitre baissée. La température de début d’après-midi et l’absence manifeste de climatisation m’auraient de toute façon incité à ne pas y toucher. Vingt minutes plus tard, deux clients se présentent ensemble. Ils veulent aller à Agontikon. C’est sur notre chemin. Ils s’installent à l’arrière et nous pouvons donc partir. Trois clients devant, quatre à l’arrière, le chauffeur va pouvoir rentabiliser sa course ! En franchissant le portail, il se retourne vers moi et me demande de bien garder mon bras à l’extérieur pour tenir la porte ; La serrure est cassée, il est plus prudent de bien la tenir…
La sécheresse des derniers mois ajoutée aux crises, économique et politique, a provoqué un exode rural massif. Les mobylettes, motos, pick-up et autre minibus ont envahi les artères habituellement calmes de la capitale. La variété des klaxons est inimaginable pour quiconque ne connait pas l’Afrique. Du simple avertisseur de deux roues à la sirène de poids lourd, sans oublier les sifflets des agents de police perchés sur des guérites blanches, ou courageux piétons aventurés au milieu du carrefour ; le concert est assourdissant et le ballet qui l’accompagne tout autant.
Je comprends assez vite que l’un des passagers assis à l’avant n’est autre qu’un cousin éloigné du chauffeur qui profite du trajet pour se faire raccompagner gratuitement chez lui. La course sera donc à répartir en cinq. Leur conversation familiale incessante est ponctuée de grands éclats de rire partagés par les autres passagers à l’exception d’une jeune femme bien calée entre son voisin de gauche et moi. En s’installant, elle avait demandé au chauffeur l’autorisation de garder avec elle une marmite encore fumante du ragoût qu’elle apportait à son mari hospitalisé dans une clinique de Misssite. C’est le seul moment où j’ai entendu le son de sa voix. Elle est très préoccupée, voire inquiète et semble ailleurs. Les autres passagers ne se soucient pas d’elle et s’expriment en « français d’Afrique » dont je comprends un mot sur trois.
Le Stade de l’Amitié est assez loin du centre-ville et je fais les derniers kilomètres seul dans le taxi avec le chauffeur. La situation est plutôt cocasse ; je suis toujours agrippé à ma portière et le conducteur est à moitié tourné vers moi pour discuter. Il m’explique qu’il est chauffeur indépendant et qu’il loue au mois cette voiture aux T.R.B. Il lui faut environ vingt jours de travail pour payer le loyer et le carburant. Le reste constitue son maigre salaire. Il me raconte qu’il a été conducteur d’engins militaires pendant vingt-cinq ans mais que, depuis qu’il est à la retraite, il loue ses services aux différentes compagnies de taxis de Cotonou. Il me laisse au stade en m’assurant qu’un de ses cousins, chauffeurs comme lui, viendra me chercher dans trois heures.
Me voilà, dans un stade entièrement vide. Il fait chaud, vraiment chaud et je regrette déjà de n’avoir qu’une petite bouteille d’eau dans mon sac. Une pagode se dresse à gauche de l’entrée principale. Sa construction avait été exigée par les Chinois qui avaient offert, en 1983, le stade à l’Etat du Bénin. Tout est déjà presque en ruine ; les peintures s’écaillent et quelques éléments d’ornements pendent du toit dont quelques tuiles jonchent le sol. Le stade est très impressionnant. Animé par la curiosité et la recherche d’ombre, je pénètre dans les vestiaires et autres locaux administratifs totalement abandonnés.
J’ai l’étrange sensation de me trouver dans le stade de Santiago du Chili que j’avais vu dans Missing, le film de Costa-Gavras. Les bureaux vides semblent résonner de cris de prisonniers torturés. Je rejoins vite la pelouse jaunie par un soleil de plomb. Je fais quelques croquis de ce lieu hors du temps, sans rencontrer âme qui vive et sors pour attendre mon taxi.
Le stade était à cette époque au milieu de nulle part, dans une sorte de banlieue désœuvrée. Pas d’ombre, pas de bar ou de boutique, pour me rafraîchir. Quelques rares passages de fourgons surchargés, lancés à pleine vitesse sur une route défoncée. J’attends une bonne demi-heure après l’heure convenue, jusqu’à ce qu’une Renault 4 blanche s’arrête à ma hauteur. « Bonjour, ça va ? Je suis le cousin de Ferdinand qui vous a déposé tout à l’heure. Je m’appelle Edmond, c’est moi qui vais vous reconduire au centre-ville » Je m’installe à ses côtés et la conversation embraye sur ce stade chinois étrange. Il m’explique qu’il a été offert en compensation de marchés accordés par le gouvernement précédent et que l’électricité et l’eau n’arrivant plus à la piscine qui jouxte le stade, il est à l’abandon depuis plus de trois ans. Lui-même, professeur de géographie, n’est plus payé depuis plusieurs mois. Il est donc devenu chauffeur de taxi avec son propre véhicule, une vieille Peugeot 304 qui est actuellement est en panne. Il lui manque mille cinq cents francs CFA pour la remettre en état. Il en a besoin pour travailler et gagner l’argent nécessaire pour faire vivre sa famille. Sa femme n’a pas de travail et leurs deux enfants sont encore très jeunes. En attendant il utilise cette R4 GTL que lui confie une compagnie de taxi contre… quatre-vingt-dix pour cent des recettes.
Arrivé à destination, il m’indique que le tarif est de cent francs CFA. Je lui réponds qu’à l’aller on m’avait demandé mille francs CFA, qui avaient été ramenés à huit cents après négociation. J’avais naturellement prévu la même somme pour le retour. Je lui tends donc huit cents francs CFA. Il refuse tout net en me disant que ce n’est pas parce que je me suis fait rouler à l’aller qu’il faut payer n’importe quel prix au retour. J’insiste. Mes arguments arrivent tout de même à le convaincre.
En Afrique, le client est toujours obligé de marchander.
Même pour payer plus cher !
Lu par Florence DEMAY
Florence DEMAY
Auteure, metteur en scène, directrice d’acteurs et comédienne, Florence Demay en même temps que ses études de lettres modernes , a effectué une formation Théâtrale classique, puis a exploré des formes contemporaines, tant dans des lieux majeurs comme le théâtre Gyptis ou Le Toursky (Marseille), que sur des scènes plus intimes entre Marseille, Paris ou Montréal.
Née dans le quartier populaire qui lui a donné son nom : la belle de mai elle y développe des différents ateliers de réinsertion par le théâtre ou la réappropriation de la parole de manière générale notamment au sein de la prison des Baumettes.
De « plus belle la vie » à « section de recherche » en passant par « la stagiaire » ou « Caïn », elle se partage entre les plateaux de Théâtre et les fictions diverses pour enfin porter différents projets de l’écriture à la réalisation .
Conduite accompagnée (texte)
- Nous sommes à Honfleur. Magnifique port de la côte normande. Une petite voiture grise roule tranquillement sur le quai, près de la grande roue. A son bord deux femmes sont en grande discussion. Si nous étions assis à côté d’elles nous pourrions entendre ce dialogue entre Martine et sa fille Judith.
– Regarde, il y a un grand parking, je vais pouvoir te laisser le volant.
– Tu penses que je vais y arriver ?
– Oui j’en suis sûre. On a bien révisé la théorie avant de partir. Ça va aller.
– Tu sais ce que disait Einstein sur la différence entre la théorie et la pratique ? « C’est la même chose … en théorie. »
– D’accord, oublions les grandes théories et passons à l’action.
– Donc, je règle mon siège, le volant et les rétroviseurs. Je débraye, je passe la première, je jette un coup d’œil dans le rétro et j’accélère lentement tout en lâchant la pédale d’embrayage.
– Et maintenant tu refais ça en enlevant le frein à main et ça devrait aller. Va déjà en face sur la troisième place libre, en marche avant.
– Ne te moque pas de moi.
– Non pas du tout. C’est parfait. On refait ça deux ou trois fois et ensuite si tu t’en sens capable, on ira sur la route ?
– Oui. C’est pas évident de coordonner les jambes, les mains et les yeux. Mais ça va.
– Pour moi c’est bon. On se lance dans la circulation.
– Je vais où ?
– Où tu veux. Mais d’abord on pourrait aller jusqu’à l’église Sainte Catherine, il y a de la place pour se garer devant, ça fera une pause.
– J’ai peur d’appuyer trop fort sur l’accélérateur. Je vais tenter de doser sans caler.
– Fais comme sur le parking. Tu as très bien dosé sur le parking. Là, très bien. N’oublie pas ton clignotant. Parfait.
– C’est dingue toute cette circulation.
– A quinze heures, un mercredi après-midi ? C’est plutôt calme en fait.
– Moi je trouve qu’il y a du monde.
– Regarde bien dans les rétroviseurs. Anticipe ton freinage. Non pas en roues libres, c’est dangereux !
– Ah, voilà l’église. On va s’arrêter. Je vais descendre marcher un peu.
– Déjà. Mais on vient de partir.
– J’ai le mollet droit tout crispé.
– Ok mais pas trop longtemps. Je reste là le temps que tu fasses un tour de l’église.
– On peut repartir, je suis prête.
– Avant d’arriver sur la nationale, je te propose de faire un petit exercice mental. Dis-toi que quand tu conduis, tu es dans une histoire dont le décor est la rue avec les trottoirs, les maisons, les arbres, les magasins, les panneaux publicitaires… et que les autres véhicules et les piétons sont les personnages. Toi, tu es la narratrice, celle qui raconte l’histoire. Quand tu vois une personne qui attend sur le trottoir, tu te dis qu’elle va aller chercher du pain à la boulangerie que tu vois à gauche au loin, quand une moto te double, tu te dis que c’est un amoureux qui fonce voir sa belle, quand une voiture tourne devant toi sans clignotant tu te dis qu’elle est conduite par un manchot qui ne peut pas attraper le clignotant de gauche… Quand tu vois un stop, tu te dis qu’il va falloir changer de paragraphe, un feu rouge, tourner la page. La signalisation te permet de ne pas trop te laisser emporter par ton imagination. Ok ?
– Super idée. Je vais essayer. Oh le joli garçon sur le vélo ! Je vais le suivre.
– Mauvaise idée. De toute façon il s’arrête pour poster une lettre. Regarde plus loin.
– Bon d’accord. Je tourne la page. Je passe en première et en route pour l’aventure. Regarde ces arbres, on dirait un tunnel de feuilles et au bout ça monte, de tout en haut on verra toute la plaine et peut-être l’océan. J’y vais. Tu vois cette camionnette blanche, je suis sûre qu’elle y va aussi. On va dire que c’est mon éclaireur. Je vais la suivre.
– C’est un peu risqué si tu veux vraiment aller tout en haut sur la colline.
– Pourquoi ?
– Elle vient de mettre son clignotant pour aller livrer le boucher.
– Mais enfin, c’est mon histoire ou la tienne ? Je vais reprendre et aller tranquillement jusqu’au château au sommet de cette fameuse colline.
– Tu veux faire comme une coccinelle ? Aller le plus haut possible et t’envoler ?
– Tu ne crois pas si bien dire. C’est exactement ce que je compte faire.
– Ok. Pour l’instant, reste concentré sur la route.
– Je reprends. Je regarde le plus loin possible et je passe les vitesses en douceur. Je contrôle ce qui se passe dans les rétroviseurs.
– Parfait. On dirait que tu as fait ça toute ta vie.
– Ca commence à monter. Encore quelques kilomètres et on y sera. Il y a de moins en moins de boutiques, quelques enfants jouent sur les trottoirs. Je me demande ce que je fais là. Je suis peut-être une détenue qui sort de prison et qui retrouve une ville complétement changée. Ou plutôt la châtelaine qui revient de voyage et qui découvre ses sujets pleins de vie. Je vais en profiter et rouler lentement.
– Mais quelle imagination ! C’est parfait.
– On arrive au sommet. Je vais aller jusqu’au belvédère et me garer sous les platanes.
– On dirait que tu connais bien cet endroit en fait.
– Tu sais avant mon accident, je montais souvent ici. Ca me rappelle ma jeunesse. Quand je venais voir le coucher de soleil avec ton père.
– Maintenant que tu es guérie et que tu conduis comme une jeune femme, tu vas pouvoir revenir autant de fois que tu voudras, Maman.
Judith serre alors tendrement la main de sa mère, encore toute crispée sur le pommeau du levier de vitesse.
D’après une idée d’Hector Manuel
 https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/06/Etape-17.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-08-31 12:16:472024-08-31 12:18:15Etape 17
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/06/Etape-17.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-08-31 12:16:472024-08-31 12:18:15Etape 17 https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/08/Bonus-3.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-08-29 23:45:002024-08-30 18:05:30Bonus Rencontre avec Daniel PICOULY
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/08/Bonus-3.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-08-29 23:45:002024-08-30 18:05:30Bonus Rencontre avec Daniel PICOULY https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/05/Partie-16.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-05-23 23:45:002024-06-11 19:29:21ETAPE 16
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/05/Partie-16.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-05-23 23:45:002024-06-11 19:29:21ETAPE 16 https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/05/Partie-15.jpg
696
696
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-05-16 23:45:002024-05-23 22:31:23ETAPE 15
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/05/Partie-15.jpg
696
696
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-05-16 23:45:002024-05-23 22:31:23ETAPE 15 https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/05/Victor-Jabouille-vignette-2.jpg
300
300
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-05-04 19:40:092024-05-04 19:53:58Bonus – Entretien avec Victor Jabouille
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/05/Victor-Jabouille-vignette-2.jpg
300
300
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-05-04 19:40:092024-05-04 19:53:58Bonus – Entretien avec Victor Jabouille https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/02/Partie-14.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-02-01 23:45:002024-02-01 15:05:21Etape 14
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/02/Partie-14.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-02-01 23:45:002024-02-01 15:05:21Etape 14 https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/01/Bonus-1.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-01-19 15:25:382024-01-26 18:08:59Bonus – Entretien avec Nicolas Pagnol
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/01/Bonus-1.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-01-19 15:25:382024-01-26 18:08:59Bonus – Entretien avec Nicolas Pagnol https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/01/Partie-13-b.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-01-18 23:45:002024-01-18 16:04:31ETAPE 13
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/01/Partie-13-b.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-01-18 23:45:002024-01-18 16:04:31ETAPE 13 https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/01/Partie-12.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-01-10 21:37:002024-01-10 21:37:02ETAPE 12
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2024/01/Partie-12.jpg
500
500
Bruno Manuel
https://brunomanuel.fr/wp-content/uploads/2023/09/logo-virgiles-et-pix.png
Bruno Manuel2024-01-10 21:37:002024-01-10 21:37:02ETAPE 12

